| Joueb.com
Envie de créer un weblog ? |
ViaBloga
Le nec plus ultra pour créer un site web. |
| Joueb.com
Envie de créer un weblog ? |
ViaBloga
Le nec plus ultra pour créer un site web. |
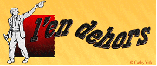




Participer à la lutte historique pour un monde meilleur
« De Fabel van de illegaal » (« La Fable de l’illégalité », http://www.defabel.nl/) est une organisation de la gauche révolutionnaire à Leiden, aux Pays-Bas. Elle concentre ses activités sur la lutte contre le racisme et contre le contrôle de l’immigration. Cette interview a été réalisée en 2005. Depuis, « De Fabel », tout en continuant à faire paraître son organe bimestriel, a participé avec d’autres groupes à la création d’une nouvelle organisation « Doorbrak », présente dans huit villes des Pays-Bas et qui se développe progressivement comme l’indique Eric dans un post-scriptum ajouté à la fin de cette interview.
Commençons par donner quelques chiffres. Leiden est une ville de 118 000 habitants et les Pays-Bas en comptent officiellement 16,2 millions. Le gouvernement considère que 3 millions d’entre eux sont des « allochtones », ce qui signifie qu’eux-mêmes, ou au moins un de leurs parents, sont nés à l’étranger. Environ 1,6 millions des « allochtones » sont appelés des « allochtones non occidentaux », c’est-à-dire qu’eux-mêmes, ou un de leurs parents, sont originaires du « tiers monde ». La plupart des « allochtones » (2,3 millions) ont un passeport néerlandais et beaucoup d’entre eux sont nés aux Pays-Bas. Les catégories d’ « allochtones » et d’« allochtones non occidentaux » ont été créées pour traiter de façon différente – c’est-à-dire répressive – les individus « de couleur », le tout sans utiliser ouvertement de termes racistes.
Parmi les « allochtones non occidentaux », on compte 320000 Turcs, 272 000 Marocains, 310 000 Surinamiens et 117 000 Antillais. Les Antillais sont aussi considérés comme des « allochtones », même si aucun d’entre eux, ni aucun de leurs parents, ne peut être né à l’étranger, puisque les Antilles font officiellement partie du royaume néerlandais. Donc, en ce qui concerne les Antillais, le seul critère de classification pour l’Etat est la couleur de leur peau.
Les communautés de réfugiés les plus importantes viennent de l’ancienne Yougoslavie (71 000), d’Irak (38 000), de Somalie (30 000), d’Afghanistan (26 000), d’Iran (24 000), du Ghana (16 000) et du Vietnam (15 000).
En dehors de toutes ces statistiques, on compte aussi un nombre croissant de travailleurs qui sont plongés dans l’illégalité par le gouvernement, puisque celui-ci leur refuse une carte de résident ou le statut de réfugié. Beaucoup d’entre eux ne déposent même plus de demande de régularisation, car leurs chances d’obtenir une carte de résident sont proches de zéro aujourd’hui. On estime qu’il y aurait, aux Pays-Bas, entre 50 000 et 320 000 « clandestins ».
![]() Quelle était la situation de la gauche révolutionnaire aux Pays-Bas quand vous avez commencé à vous intéresser à la politique ?
Quelle était la situation de la gauche révolutionnaire aux Pays-Bas quand vous avez commencé à vous intéresser à la politique ?
![]() Eric :
J’ai commencé à m’intéresser à la politique dans les années 1980.
Contrairement à aujourd’hui, la gauche révolutionnaire était
florissante à l’époque. Au début des années 1980, beaucoup de jeunes
éprouvaient de la sympathie pour le mouvement des squatters. Mes amis
et moi, à l’époque, nous ne participions pas directement à des squats,
mais nous avons tous écouté la radio durant les énormes émeutes
d’Amsterdam du 30 avril 1980. Ce jour-là était celui du couronnement de
la reine Beatrix, mais le mouvements des squatters avait averti le
pouvoir : « Pas de maisons, pas de couronnement. » Amsterdam fut
transformé en un champ de bataille, avec barricades, affrontements, gaz
lacrymogène, etc., et les squatters faillirent réussir à pénétrer dans
l’église où se déroulait le couronnement. Ce ne fut pas un jour de
gloire pour la monarchie.
Eric :
J’ai commencé à m’intéresser à la politique dans les années 1980.
Contrairement à aujourd’hui, la gauche révolutionnaire était
florissante à l’époque. Au début des années 1980, beaucoup de jeunes
éprouvaient de la sympathie pour le mouvement des squatters. Mes amis
et moi, à l’époque, nous ne participions pas directement à des squats,
mais nous avons tous écouté la radio durant les énormes émeutes
d’Amsterdam du 30 avril 1980. Ce jour-là était celui du couronnement de
la reine Beatrix, mais le mouvements des squatters avait averti le
pouvoir : « Pas de maisons, pas de couronnement. » Amsterdam fut
transformé en un champ de bataille, avec barricades, affrontements, gaz
lacrymogène, etc., et les squatters faillirent réussir à pénétrer dans
l’église où se déroulait le couronnement. Ce ne fut pas un jour de
gloire pour la monarchie.
Au cours des années suivantes, de nombreuses opérations d’expulsion menées contre des squats aboutirent à de gigantesques batailles de rue, et le gouvernement lança même des chars dans les rues. La majorité des jeunes de cette époque (j’avais 18 ans en 1980), étaient fascinés par le mouvement des squatters, son énergie et sa mentalité anti-autoritaire et autogestionnaire. Il faut aussi souligner qu’il y avait à l’époque un gouvernement de droite pour la première fois depuis de nombreuses années. Il commença par bloquer les salaires des fonctionnaires, opérer des coupes dans le budget de la Sécurité sociale, etc. Cela provoqua de nombreuses grèves. Et le gouvernement voulait aussi installer des missiles nucléaires américains sur des bases militaires aux Pays-Bas. Cela conduisit aux deux plus grandes manifestations qui aient jamais eu lieu dans notre pays. 400 000 personnes manifestèrent à Amsterdam le 21 novembre 1981, et 550 000 le 29 octobre 1983.
Cela a eu un puissant impact sur notre génération, même si je n’ai pas moi-même participé à ces manifestations. On avait l’impression que toute la population était dans la rue. Le mouvement des squats forma bientôt une des ailes radicales de ce gigantesque mouvement. La même chose se produisit avec le mouvement contre l’apartheid en Afrique du Sud, qui était devenu la question la plus importante pour la gauche et l’extrême gauche au cours de la seconde moitié des années 1980. Cela avait un rapport évident avec le fait que l’Afrique du Sud était une ex-colonie néerlandaise.
La gauche révolutionnaire se lança bientôt dans la campagne contre la compagnie anglo-néerlandaise Shell, et essaya de forcer la multinationale à interrompre ses relations commerciales avec le régime de l’apartheid. La RARA (Action radicale antiraciste) mit le feu à plusieurs entrepôts de la société Makro, lui causant des millions d’euros de pertes et forçant l’entreprise à quitter l’Afrique du Sud. Toutes ces questions et ces mouvements eurent une profonde influence sur la plupart d’entre nous qui étions déjà en âge de réfléchir à la situation politique.
![]() Pourquoi, comment et quand avez-vous rejoint « De Fabel » ?
Pourquoi, comment et quand avez-vous rejoint « De Fabel » ?
![]() Harry :
« De Fabel » a été créé au début des années 1990. Mais, tout comme
Eric, j’ai commencé aussi à m’intéresser à la politique durant les
années 1980, spécialement dans des campagnes contre le racisme,
l’apartheid, l’énergie nucléaire et les armes nucléaires. À l’époque,
il y avait beaucoup de groupes extraparlementaires et révolutionnaires.
Les mouvements sociaux étaient aussi beaucoup plus importants.
Harry :
« De Fabel » a été créé au début des années 1990. Mais, tout comme
Eric, j’ai commencé aussi à m’intéresser à la politique durant les
années 1980, spécialement dans des campagnes contre le racisme,
l’apartheid, l’énergie nucléaire et les armes nucléaires. À l’époque,
il y avait beaucoup de groupes extraparlementaires et révolutionnaires.
Les mouvements sociaux étaient aussi beaucoup plus importants.
J’ai commencé à travailler dans une librairie de gauche à Leiden, à l’âge de 24 ans, et après avoir abandonné des études de droit. Ensuite j’ai bossé dans une boutique spécialisée dans les produits du tiers monde, le commerce équitable, etc. Ces deux boulots étaient bénévoles. Dans la librairie je parlais beaucoup avec les clients, qui étaient surtout des militants qui venaient déposer leurs publications. Puis j’ai fait partie de plusieurs comités de lutte, dont un groupe anti-apartheid. J’ai aussi participé à des comités contre l’énergie nucléaire et contre les armes nucléaires. Je raisonnais de façon individuelle, pour moi, la politique était presque un hobby. Bien sûr, je faisais cela sérieusement mais ce n’était pas une activité à plein temps. Tu connaissais quelqu’un, il te proposait de lui donner un coup de main pour une action ou t’invitait à une réunion, ou à une manifestation.
À la fin des années 80, j’avais envie d’avoir une vie plus politique. J’avais 30 ans et je voulais que mes activités soient plus structurées. Mes idées avaient évolué vers la gauche révolutionnaire et je cherchais à rejoindre ou former un groupe. Au début de 1990, nous avons créé un centre d’information – « De Invalshoek » (« Perspective ») – que nous avons installé dans un bureau vide au-dessus de la librairie. Nous avions une bibliothèque, et c’était surtout un lieu de réunion pour les militants. Malheureusement, au même moment, les mouvements sociaux étaient rapidement en train de s’effondrer. Le mur de Berlin était tombé et les mouvements révolutionnaires dans le monde entier ont perdu leur élan. La croyance que l’on pouvait changer la société disparaissait rapidement. La plupart des gens ont commencé à penser que la social-démocratie était la seule solution. Et rapidement la gauche révolutionnaire néerlandaise, toutes tendances confondues, s’est réduite à quelques centaines de personnes.
![]() Eric :
En ce qui me concerne, j’ai commencé à m’intéresser sérieusement à la
politique vers 1984, principalement grâce à mes lectures. Je
n’appréciais guère la vie que je menais. J’avais échoué dans mes études
de physique et je savais que l’armée allait m’appeler pour que je fasse
mon service militaire. J’ai adhéré au syndicat (social-démocrate) des
soldats. Ensuite j’ai étudié la psychologie et, continué à lire des
bouquins de sociologie, et aussi des ouvrages sur le socialisme,
l’humanisme, l’anarchisme, le communisme, etc. Je n’étais attiré par
aucun parti politique particulier. J’ai découvert la librairie où
travaillait Harry et toutes sortes de revues et de journaux dans
lesquels mes idées théoriques étaient mises en pratique. J’ai lu des
articles, par exemple, sur les actions radicales contre la Shell,
comment des militants découpaient des centaines de tuyaux dans toutes
les stations d’essence du pays. Mais à cause de la nature illégale de
ces actions, je ne savais pas qui étaient ces militants et ni comment
les contacter. Je me suis investi dans le mouvement anti-psychiatrie
qui accueillait les patients fuyant les hôpitaux fermés et organisait
des actions contre les électrochocs, les chambres d’isolement et la
médication forcée. Je ne voulais pas simplement aider les gens, mais
changer fondamentalement tout le système. Au début de 1990, j’avais
alors 27 ans, j’ai rejoint le projet de Harry de créer un centre
d’information.
Eric :
En ce qui me concerne, j’ai commencé à m’intéresser sérieusement à la
politique vers 1984, principalement grâce à mes lectures. Je
n’appréciais guère la vie que je menais. J’avais échoué dans mes études
de physique et je savais que l’armée allait m’appeler pour que je fasse
mon service militaire. J’ai adhéré au syndicat (social-démocrate) des
soldats. Ensuite j’ai étudié la psychologie et, continué à lire des
bouquins de sociologie, et aussi des ouvrages sur le socialisme,
l’humanisme, l’anarchisme, le communisme, etc. Je n’étais attiré par
aucun parti politique particulier. J’ai découvert la librairie où
travaillait Harry et toutes sortes de revues et de journaux dans
lesquels mes idées théoriques étaient mises en pratique. J’ai lu des
articles, par exemple, sur les actions radicales contre la Shell,
comment des militants découpaient des centaines de tuyaux dans toutes
les stations d’essence du pays. Mais à cause de la nature illégale de
ces actions, je ne savais pas qui étaient ces militants et ni comment
les contacter. Je me suis investi dans le mouvement anti-psychiatrie
qui accueillait les patients fuyant les hôpitaux fermés et organisait
des actions contre les électrochocs, les chambres d’isolement et la
médication forcée. Je ne voulais pas simplement aider les gens, mais
changer fondamentalement tout le système. Au début de 1990, j’avais
alors 27 ans, j’ai rejoint le projet de Harry de créer un centre
d’information.
![]() Ellen :
Vers 1987, pendant mes études de psychologie, je me suis intéressée au
féminisme. J’ai commencé à comprendre les racines politiques des choses
que je voyais et expérimentais dans ma vie quotidienne. Je me suis
rapidement passionnée pour le féminisme et spécialement pour la lutte
contre les violences infligées aux femmes. À l’époque, j’ai aussi
participé à ma première manifestation. Il s’agissait de protester
contre une diminution des aides financières aux étudiants. La manif m’a
vraiment donné une décharge d’adrénaline. Il y avait des milliers
d’étudiants, des centaines de policiers à cheval, les gens chantaient
et criaient des slogans. Mes idées se sont progressivement radicalisés.
J’ai adhéré à un groupe de femmes qui tenaient un service d’assistance
téléphonique aux victimes de violences sexuelles.
Ellen :
Vers 1987, pendant mes études de psychologie, je me suis intéressée au
féminisme. J’ai commencé à comprendre les racines politiques des choses
que je voyais et expérimentais dans ma vie quotidienne. Je me suis
rapidement passionnée pour le féminisme et spécialement pour la lutte
contre les violences infligées aux femmes. À l’époque, j’ai aussi
participé à ma première manifestation. Il s’agissait de protester
contre une diminution des aides financières aux étudiants. La manif m’a
vraiment donné une décharge d’adrénaline. Il y avait des milliers
d’étudiants, des centaines de policiers à cheval, les gens chantaient
et criaient des slogans. Mes idées se sont progressivement radicalisés.
J’ai adhéré à un groupe de femmes qui tenaient un service d’assistance
téléphonique aux victimes de violences sexuelles.
En 1990, j’avais alors 28 ans, j’ai adhéré à un nouveau groupe de femmes, Sappho, qui se réunissait dans les locaux du centre d’information « De Invalshoek ». Nous organisions des discussions et des petites actions. Un an plus tard, j’ai commencé à écrire des articles pour notre journal local « De Peueraar », qui abordait surtout les questions du féminisme et du racisme. À l’époque, le mouvement féministe était en train de décliner. Beaucoup de gens pensaient que l’essentiel du travail avait été fait, que maintenant les femmes, les homosexuels et les lesbiennes étaient pratiquement égaux devant la loi. Mais, pour moi, le féminisme avait un sens plus révolutionnaire. La société n’a pas fondamentalement changé et la violence domestique, par exemple, est encore un énorme problème aujourd’hui. Je travaille désormais dans une organisation qui lutte contre la violence domestique et est financée par le conseil municipal, mais dans ma vie politique, avec « De Fabel van de illegaal », je ne donne plus la priorité au féminisme.
![]() Jan :
Mes parents étaient un peu des hippies, ils ne faisaient pas
grand-chose. Nous vivions dans un petit village. Un de leurs amis, un
anarchiste, m’a montré toutes sortes de bouquins. Plus tard, je suis
allé à des concerts de musique punk et j’ai commencé à m’intéresser aux
idées d’extrême gauche et antispécistes. J’ai fini le lycée en 1999 et
suivi certains de mes copains qui sont allés étudier à Leiden. Tout
comme eux, j’ai commencé à militer dans une organisation anarchiste
contre la Communauté européenne : EuroDusnie (qu’on peut traduire par
« L’Europe ? Pas question ! » mais il s’agit aussi d’un jeu de mots
avec Eurodisney). Au départ, « De Fabel van de illegaal » m’énervait
parce que Eric avait écrit un article à propos des tendances de droite
dans la musique punk et chez les antispécistes. Beaucoup de membres
d’Eurodusnie critiquaient « De Fabel » pour avoir quitté le mouvement
altermondialiste et dénoncé des tendances nationalistes et
potentiellement antisémites dans ce mouvement. Mais, quelques mois plus
tard, j’ai décidé de participer à la permanence de « De Fabel » pour
les sans-papiers. Quand je militais à EuroDusnie, je défendais souvent
les idées « De Fabel ». J’aimais la façon dont ce groupe travaillait.
Ils avaient des discussions sérieuses et essayaient de formuler des
conceptions politiques compréhensibles et acceptables pour les autres.
J’ai vraiment commencé une activité politique révolutionnaire quand
j’ai adhéré à « De Fabel », en 2000, alors que j’avais 20 ans.
Jan :
Mes parents étaient un peu des hippies, ils ne faisaient pas
grand-chose. Nous vivions dans un petit village. Un de leurs amis, un
anarchiste, m’a montré toutes sortes de bouquins. Plus tard, je suis
allé à des concerts de musique punk et j’ai commencé à m’intéresser aux
idées d’extrême gauche et antispécistes. J’ai fini le lycée en 1999 et
suivi certains de mes copains qui sont allés étudier à Leiden. Tout
comme eux, j’ai commencé à militer dans une organisation anarchiste
contre la Communauté européenne : EuroDusnie (qu’on peut traduire par
« L’Europe ? Pas question ! » mais il s’agit aussi d’un jeu de mots
avec Eurodisney). Au départ, « De Fabel van de illegaal » m’énervait
parce que Eric avait écrit un article à propos des tendances de droite
dans la musique punk et chez les antispécistes. Beaucoup de membres
d’Eurodusnie critiquaient « De Fabel » pour avoir quitté le mouvement
altermondialiste et dénoncé des tendances nationalistes et
potentiellement antisémites dans ce mouvement. Mais, quelques mois plus
tard, j’ai décidé de participer à la permanence de « De Fabel » pour
les sans-papiers. Quand je militais à EuroDusnie, je défendais souvent
les idées « De Fabel ». J’aimais la façon dont ce groupe travaillait.
Ils avaient des discussions sérieuses et essayaient de formuler des
conceptions politiques compréhensibles et acceptables pour les autres.
J’ai vraiment commencé une activité politique révolutionnaire quand
j’ai adhéré à « De Fabel », en 2000, alors que j’avais 20 ans.

![]() Quel genre de groupe était au départ De Fabel ?
Quel genre de groupe était au départ De Fabel ?
![]() Eric :
Avec notre centre d’information – « De Invalshoek » (« Perspective ») –
nous voulions rassembler des gens différents sur le plan local, au
niveau des groupes, des courants, des idées et des individus. Mais la
crise de la gauche révolutionnaire après la chute du mur de Berlin nous
a obligés à réexaminer les idées et les pratiques de ces courants
politiques. Nous avons commencé à une quinzaine de personnes et avons
grossi rapidement jusqu’à organiser plus de 60 personnes, qui
travaillaient dans une douzaine ou une quinzaine de comités différents.
Nous avons aussi aidé des militants dans d’autres villes des Pays-Bas à
créer des initiatives semblables. En 1992, nous avions 7 centres
d’information dans le pays et nous étions en contact avec des dizaines
d’autres en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France et en Espagne.
Ensemble, nous avons essayé de construire un réseau international
solide. Cela s’est terminé par un échec au niveau international, puis
cela a été le tour des centres d’information nationaux qui, eux aussi,
se sont arrêtés.
Eric :
Avec notre centre d’information – « De Invalshoek » (« Perspective ») –
nous voulions rassembler des gens différents sur le plan local, au
niveau des groupes, des courants, des idées et des individus. Mais la
crise de la gauche révolutionnaire après la chute du mur de Berlin nous
a obligés à réexaminer les idées et les pratiques de ces courants
politiques. Nous avons commencé à une quinzaine de personnes et avons
grossi rapidement jusqu’à organiser plus de 60 personnes, qui
travaillaient dans une douzaine ou une quinzaine de comités différents.
Nous avons aussi aidé des militants dans d’autres villes des Pays-Bas à
créer des initiatives semblables. En 1992, nous avions 7 centres
d’information dans le pays et nous étions en contact avec des dizaines
d’autres en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France et en Espagne.
Ensemble, nous avons essayé de construire un réseau international
solide. Cela s’est terminé par un échec au niveau international, puis
cela a été le tour des centres d’information nationaux qui, eux aussi,
se sont arrêtés.
![]() Qu’est-il arrivé à votre centre d’information ?
Qu’est-il arrivé à votre centre d’information ?
![]() Eric :
Le groupe central de 15 personnes, y compris Harry et moi, l’animions
sur une base quotidienne. Nos locaux étaient utilisés par un groupe
homosexuel, un groupe féministe, un groupe antispéciste, une
coopérative végétarienne, un groupe écologiste, une organisation de
chômeurs, des squatters, etc. Nous avions aussi nos propres réunions de
discussion, campagnes et actions sur des thèmes comme
l’anti-impérialisme, le racisme, le patriarcat, la flexibilité,
l’immigration, l’unification de l’Europe, etc. Et nous publions un
journal, « De Peueraar » (un mot qui désignait, il y a un siècle, les
pauvres qui survivaient en pêchant dans les canaux de Leiden). Nous
décrivions les activités de ces différents groupes et interviewions
toutes sortes de gens actifs dans la ville. Mais, au bout de quatre
ans, la plupart des autres groupes ont disparu.
Eric :
Le groupe central de 15 personnes, y compris Harry et moi, l’animions
sur une base quotidienne. Nos locaux étaient utilisés par un groupe
homosexuel, un groupe féministe, un groupe antispéciste, une
coopérative végétarienne, un groupe écologiste, une organisation de
chômeurs, des squatters, etc. Nous avions aussi nos propres réunions de
discussion, campagnes et actions sur des thèmes comme
l’anti-impérialisme, le racisme, le patriarcat, la flexibilité,
l’immigration, l’unification de l’Europe, etc. Et nous publions un
journal, « De Peueraar » (un mot qui désignait, il y a un siècle, les
pauvres qui survivaient en pêchant dans les canaux de Leiden). Nous
décrivions les activités de ces différents groupes et interviewions
toutes sortes de gens actifs dans la ville. Mais, au bout de quatre
ans, la plupart des autres groupes ont disparu.
![]() Ellen :
Deux années auparavant, des politiciens ont commencé à accuser les
migrants d’être des « délinquants et des criminels », de « profiter de
l’Etat-providence », et autres stupidités. Bolkestein a joué un rôle
dirigeant dans cette campagne. De nouvelles lois très strictes contre
l’immigration ont été votées et appliquées. Nous avons alors décidé de
nous concentrer sur les questions du racisme et de l’immigration et
avons changé de nom pour devenir « De Fabel van de illegaal ». Avec ce
nom nous voulions souligner que personne n’est « illégal » (ou
« clandestin ») et démystifier tout ce que l’on racontait et raconte
encore sur les immigrés. Aujourd’hui, nous continuons à essayer de
réorganiser la gauche révolutionnaire et de renouveler ses idées. Mais
notre principal travail consiste à soutenir les migrants et les
réfugiés, sur le plan individuel mais aussi sur le plan collectif. Nous
faisons aussi un travail antifasciste et publions des articles sur ces
sujets dans notre journal bimestriel.
Ellen :
Deux années auparavant, des politiciens ont commencé à accuser les
migrants d’être des « délinquants et des criminels », de « profiter de
l’Etat-providence », et autres stupidités. Bolkestein a joué un rôle
dirigeant dans cette campagne. De nouvelles lois très strictes contre
l’immigration ont été votées et appliquées. Nous avons alors décidé de
nous concentrer sur les questions du racisme et de l’immigration et
avons changé de nom pour devenir « De Fabel van de illegaal ». Avec ce
nom nous voulions souligner que personne n’est « illégal » (ou
« clandestin ») et démystifier tout ce que l’on racontait et raconte
encore sur les immigrés. Aujourd’hui, nous continuons à essayer de
réorganiser la gauche révolutionnaire et de renouveler ses idées. Mais
notre principal travail consiste à soutenir les migrants et les
réfugiés, sur le plan individuel mais aussi sur le plan collectif. Nous
faisons aussi un travail antifasciste et publions des articles sur ces
sujets dans notre journal bimestriel.
![]() Comment sélectionnez-vous, formez-vous et intégrez-vous de nouveaux militants à « De Fabel » ?
Comment sélectionnez-vous, formez-vous et intégrez-vous de nouveaux militants à « De Fabel » ?
![]() Ellen :
Nous ne cherchons pas vraiment à « recruter » de nouveaux membres.
Parfois des militants nous demandent s’ils peuvent nous rejoindre après
avoir lu notre journal ou participé avec nous à des actions. Et parfois
des immigrés veulent nous rejoindre après nous avoir rencontré à notre
permanence. Nous n’acceptons pas n’importe qui. Il ne suffit pas pour
nous que quelqu’un veuille seulement aider les sans-papiers. Nous ne
voulons pas de membres qui aient l’esprit d’un travailleur social, ou
une mentalité similaire. Nous sommes une organisation politique. Et tu
ne peux pas nous rejoindre juste pour quelques mois, parce que cela
prend du temps si tu veux connaître les idées de notre organisation.
Bien sûr, quand tu fais partie de notre groupe, tu n’es pas obligé
d’être d’accord sur tous les points, mais tu dois avoir l’esprit ouvert
et bien connaître les positions que nous défendons. Certains nouveaux
membres ont parfois du mal à accepter que nous critiquons aussi la
gauche révolutionnaire, et que si nous soutenons les luttes des
migrants, nous critiquons aussi, par exemple, le nationalisme basque ou
arabe. Nous demandons à ceux qui veulent nous rejoindre de nous
expliquer d’abord ce qu’ils connaissent de nos positions et de nos
activités, ce qu’ils veulent faire exactement et combien d’heures par
semaine ils peuvent consacrer à une activité politique. Nous leur
expliquons évidemment ce que nous faisons et ce que nous demandons aux
militants. Lors de notre réunion bihebdomadaire, nous décidons si la
personne peut rejoindre notre groupe. Puis, l’un d’entre nous devient
le mentor du nouvel adhérent et l’aide à s’orienter pendant deux mois.
C’est un peu comme une formation rapide. Après ces deux mois, nous
décidons ensemble avec le nouveau sympathisant si elle (ou il) et le
groupe s’entendent bien personnellement et politiquement.
Ellen :
Nous ne cherchons pas vraiment à « recruter » de nouveaux membres.
Parfois des militants nous demandent s’ils peuvent nous rejoindre après
avoir lu notre journal ou participé avec nous à des actions. Et parfois
des immigrés veulent nous rejoindre après nous avoir rencontré à notre
permanence. Nous n’acceptons pas n’importe qui. Il ne suffit pas pour
nous que quelqu’un veuille seulement aider les sans-papiers. Nous ne
voulons pas de membres qui aient l’esprit d’un travailleur social, ou
une mentalité similaire. Nous sommes une organisation politique. Et tu
ne peux pas nous rejoindre juste pour quelques mois, parce que cela
prend du temps si tu veux connaître les idées de notre organisation.
Bien sûr, quand tu fais partie de notre groupe, tu n’es pas obligé
d’être d’accord sur tous les points, mais tu dois avoir l’esprit ouvert
et bien connaître les positions que nous défendons. Certains nouveaux
membres ont parfois du mal à accepter que nous critiquons aussi la
gauche révolutionnaire, et que si nous soutenons les luttes des
migrants, nous critiquons aussi, par exemple, le nationalisme basque ou
arabe. Nous demandons à ceux qui veulent nous rejoindre de nous
expliquer d’abord ce qu’ils connaissent de nos positions et de nos
activités, ce qu’ils veulent faire exactement et combien d’heures par
semaine ils peuvent consacrer à une activité politique. Nous leur
expliquons évidemment ce que nous faisons et ce que nous demandons aux
militants. Lors de notre réunion bihebdomadaire, nous décidons si la
personne peut rejoindre notre groupe. Puis, l’un d’entre nous devient
le mentor du nouvel adhérent et l’aide à s’orienter pendant deux mois.
C’est un peu comme une formation rapide. Après ces deux mois, nous
décidons ensemble avec le nouveau sympathisant si elle (ou il) et le
groupe s’entendent bien personnellement et politiquement.
![]() Harry :
On ne peut pas être un membre passif de « De Fabel ». Nous n’avons pas
un « chef » qui nous dise ce qu’il faut faire. Donc nous attendons de
nos membres qu’ils soient actifs, qu’ils prennent des initiatives et
contribuent à l’activité collective. En ce sens, nous sommes différents
des partis politiques. Nous sommes une petite organisation, mais tous
nos membres sont très actifs.
Harry :
On ne peut pas être un membre passif de « De Fabel ». Nous n’avons pas
un « chef » qui nous dise ce qu’il faut faire. Donc nous attendons de
nos membres qu’ils soient actifs, qu’ils prennent des initiatives et
contribuent à l’activité collective. En ce sens, nous sommes différents
des partis politiques. Nous sommes une petite organisation, mais tous
nos membres sont très actifs.
![]() Eric :
Il est parfois difficile, pour les nouveaux membres, de comprendre
notre façon d’être autonome, au sein d’une structure collective. C’est
une attitude politique très liée aux premiers mouvements autonomes et
de squatters. La plupart des gens n’ont pas l’habitude de ce type
d’attitude. À l’école et au boulot, on leur dit toujours d’obéir et ils
s’attendent à ce que les autres, dans un groupe révolutionnaire, leur
disent ce qu’ils doivent faire. Mais, au bout de quelques années à « De
Fabel », la plupart des membres développent un esprit différent, plus
autonome. Et c’est le résultat de l’éducation qu’ils reçoivent chez
nous. Souvent, quand ils quittent notre groupe, ils ont du mal à se
réinsérer dans des structures hiérarchiques traditionnelles.
Eric :
Il est parfois difficile, pour les nouveaux membres, de comprendre
notre façon d’être autonome, au sein d’une structure collective. C’est
une attitude politique très liée aux premiers mouvements autonomes et
de squatters. La plupart des gens n’ont pas l’habitude de ce type
d’attitude. À l’école et au boulot, on leur dit toujours d’obéir et ils
s’attendent à ce que les autres, dans un groupe révolutionnaire, leur
disent ce qu’ils doivent faire. Mais, au bout de quelques années à « De
Fabel », la plupart des membres développent un esprit différent, plus
autonome. Et c’est le résultat de l’éducation qu’ils reçoivent chez
nous. Souvent, quand ils quittent notre groupe, ils ont du mal à se
réinsérer dans des structures hiérarchiques traditionnelles.
![]() Ellen :
Nous n’avons pas de hiérarchie. En pratique, cela veut dire, par
exemple, que tout le monde doit nettoyer à son tour les chiottes du
local. Nous considérons que chaque membre doit assister aux réunions
bimensuelles et tenir la permanence au moins une après-midi par
semaine, répondre au téléphone, orienter les visiteurs dans notre
bibliothèque. Et aussi participer à au moins un de nos groupes de
travail concernant les actions de soutien collectives ou individuelles
aux sans-papiers, l’antifascisme, le journal, la comptabilité, etc.
Ellen :
Nous n’avons pas de hiérarchie. En pratique, cela veut dire, par
exemple, que tout le monde doit nettoyer à son tour les chiottes du
local. Nous considérons que chaque membre doit assister aux réunions
bimensuelles et tenir la permanence au moins une après-midi par
semaine, répondre au téléphone, orienter les visiteurs dans notre
bibliothèque. Et aussi participer à au moins un de nos groupes de
travail concernant les actions de soutien collectives ou individuelles
aux sans-papiers, l’antifascisme, le journal, la comptabilité, etc.
![]() Jan :
Tout le monde ne peut pas participer immédiatement au groupe qui
s’occupe d’écrire des articles. Il faut que tu sois capable d’exprimer
les idées que nous avons développées durant toutes ces années. Nous ne
tenons pas à ce que, tout à coup, quelqu’un écrive quelque chose de
positif sur le capitalisme, le patriarcat ou le racisme. Quand l’un de
nos membres écrit un article, nous le discutons toujours collectivement
avant qu’il soit publié. Personnellement, j’ai du mal à écrire, mais
Harry et Eric corrigent mes textes, et en discutant j’ai beaucoup
appris. Nous nous éduquons les uns les autres.
Jan :
Tout le monde ne peut pas participer immédiatement au groupe qui
s’occupe d’écrire des articles. Il faut que tu sois capable d’exprimer
les idées que nous avons développées durant toutes ces années. Nous ne
tenons pas à ce que, tout à coup, quelqu’un écrive quelque chose de
positif sur le capitalisme, le patriarcat ou le racisme. Quand l’un de
nos membres écrit un article, nous le discutons toujours collectivement
avant qu’il soit publié. Personnellement, j’ai du mal à écrire, mais
Harry et Eric corrigent mes textes, et en discutant j’ai beaucoup
appris. Nous nous éduquons les uns les autres.
![]() Eric :
Nous incitons les nouveaux membres à lire certains livres et bien sûr
les textes que nous avons écrits. Nous avons rassemblé, par thème, les
articles théoriques les plus importants que nous avons écrits au cours
des 15 dernières années dans des brochures. Et ceux qui jouent le rôle
de mentor et d’autres discutent avec les nouveaux membres. Cela permet
d’assurer une formation politique minimale. Les nouveaux arrivants
peuvent apporter de nouvelles idées. Nous devons aussi garder un esprit
ouvert et écouter ce qu’ils disent et pensent. Nous essayons aussi
d’apprendre de ceux qui nous quittent, en discutant avec eux pour
savoir ce qui n’a pas marché.
Eric :
Nous incitons les nouveaux membres à lire certains livres et bien sûr
les textes que nous avons écrits. Nous avons rassemblé, par thème, les
articles théoriques les plus importants que nous avons écrits au cours
des 15 dernières années dans des brochures. Et ceux qui jouent le rôle
de mentor et d’autres discutent avec les nouveaux membres. Cela permet
d’assurer une formation politique minimale. Les nouveaux arrivants
peuvent apporter de nouvelles idées. Nous devons aussi garder un esprit
ouvert et écouter ce qu’ils disent et pensent. Nous essayons aussi
d’apprendre de ceux qui nous quittent, en discutant avec eux pour
savoir ce qui n’a pas marché.
![]() Ellen :
Il faut être réaliste. Les gens qui quittent « De Fabel », ou d’autres
groupes révolutionnaires, le font parce qu’ils trouvent que le groupe
est trop politique, trop exigeant, ou leur prend trop de temps. Il est
évident que tout le monde ne peut pas devenir un militant politique et
un « idéologue » à plein temps.
Ellen :
Il faut être réaliste. Les gens qui quittent « De Fabel », ou d’autres
groupes révolutionnaires, le font parce qu’ils trouvent que le groupe
est trop politique, trop exigeant, ou leur prend trop de temps. Il est
évident que tout le monde ne peut pas devenir un militant politique et
un « idéologue » à plein temps.
![]() Quelles sont les différences entre De Fabel et une ONG ?
Quelles sont les différences entre De Fabel et une ONG ?
![]() Jan :
Une ONG critique certaines situations, mais jamais de façon
fondamentale. Les ONG essayent d’aider les gens et elles travaillent
sur des solutions temporaires. Nous, nous voulons une révolution. Toute
la société doit changer. Nous essayons de combattre avec des gens qui
ont le même but, ou au moins qui avancent des revendications exigeant
des changements sociaux fondamentaux. Par exemple, en ce qui concerne
les problèmes des sans-papiers, une ONG se chargerait de leur trouver
des médecins. Nous le faisons aussi, mais nous luttons ensemble avec
les sans-papiers et la gauche révolutionnaire contre la politique
migratoire du gouvernement et sa politique d’exclusion qui sont les
premiers responsables des problèmes des migrants. Nous essayons
également de développer à chaque fois l’analyse de la gauche
révolutionnaire. Les ONG ne font pas ce travail.
Jan :
Une ONG critique certaines situations, mais jamais de façon
fondamentale. Les ONG essayent d’aider les gens et elles travaillent
sur des solutions temporaires. Nous, nous voulons une révolution. Toute
la société doit changer. Nous essayons de combattre avec des gens qui
ont le même but, ou au moins qui avancent des revendications exigeant
des changements sociaux fondamentaux. Par exemple, en ce qui concerne
les problèmes des sans-papiers, une ONG se chargerait de leur trouver
des médecins. Nous le faisons aussi, mais nous luttons ensemble avec
les sans-papiers et la gauche révolutionnaire contre la politique
migratoire du gouvernement et sa politique d’exclusion qui sont les
premiers responsables des problèmes des migrants. Nous essayons
également de développer à chaque fois l’analyse de la gauche
révolutionnaire. Les ONG ne font pas ce travail.
![]() Peux-tu donner un exemple plus précis ?
Peux-tu donner un exemple plus précis ?
![]() Eric :
Aux Pays-Bas, la gauche révolutionnaire critique habituellement le
gouvernement parce qu’il empêche les réfugiés politiques d’entrer dans
le pays et parce qu’il expulse ceux qui ont réussi à entrer. Ces
arguments sont justes mais insuffisants. La gauche révolutionnaire doit
comprendre que le gouvernement laisse aussi entrer une partie des
travailleurs étrangers, qu’il sélectionne les migrants selon les
besoins du marché du travail. C’est pourquoi il est important de
réfléchir aux contrôles des migrations et à la politique démographique.
Et une telle réflexion inclut automatiquement les migrants et les
réfugiés. De plus, s’interroger sur la politique démographique c’est se
poser des questions sur des contrôles encore plus larges. L’Etat ne
décide pas seulement qui a le droit (ou pas) d’entrer dans le pays, en
partant de calculs économiques. Il exerce aussi une influence sur ceux
qui ont le droit de vivre ou pas. Les personnes âgées et les handicapés
ne peuvent être productifs, c’est pourquoi le gouvernement néerlandais
apprécie tellement l’euthanasie. Les récents débats au sein du
gouvernement sur l’intégration forcée, ou même sur « l’assimilation »
des migrants, peuvent aussi être analysés sous cet angle. Les
entreprises peuvent gagner plus d’argent avec des immigrés
soigneusement assimilés selon leurs besoins.
Eric :
Aux Pays-Bas, la gauche révolutionnaire critique habituellement le
gouvernement parce qu’il empêche les réfugiés politiques d’entrer dans
le pays et parce qu’il expulse ceux qui ont réussi à entrer. Ces
arguments sont justes mais insuffisants. La gauche révolutionnaire doit
comprendre que le gouvernement laisse aussi entrer une partie des
travailleurs étrangers, qu’il sélectionne les migrants selon les
besoins du marché du travail. C’est pourquoi il est important de
réfléchir aux contrôles des migrations et à la politique démographique.
Et une telle réflexion inclut automatiquement les migrants et les
réfugiés. De plus, s’interroger sur la politique démographique c’est se
poser des questions sur des contrôles encore plus larges. L’Etat ne
décide pas seulement qui a le droit (ou pas) d’entrer dans le pays, en
partant de calculs économiques. Il exerce aussi une influence sur ceux
qui ont le droit de vivre ou pas. Les personnes âgées et les handicapés
ne peuvent être productifs, c’est pourquoi le gouvernement néerlandais
apprécie tellement l’euthanasie. Les récents débats au sein du
gouvernement sur l’intégration forcée, ou même sur « l’assimilation »
des migrants, peuvent aussi être analysés sous cet angle. Les
entreprises peuvent gagner plus d’argent avec des immigrés
soigneusement assimilés selon leurs besoins.
Nous essayons aussi d’inciter la gauche révolutionnaire à s’intéresser davantage à la question du patriarcat, à la position des migrantes et aux boulots qu’elles sont souvent obligées d’accepter. Heureusement, au cours des cinq dernières années, de nombreux révolutionnaires ont abandonné l’idéologie altermondialiste et ont commencé à s’intéresser à ce qui se passait dans leur environnement proche, à la répression et à l’exploitation des travailleurs, en particulier des immigrés. Nous avons sans doute joué un petit rôle dans cette évolution.
![]() Quelles actions a organisées « De Fabel van de illegaal » ?
Quelles actions a organisées « De Fabel van de illegaal » ?
![]() Eric :
Nous avons probablement organisé entre 100 et 150 actions au cours des
15 dernières années, de grandes actions comme de petites. Les actions
importantes ont souvent été menées avec d’autres organisations. Il
m’est impossible de les nommer toutes. Les actions les plus importantes
pour nous ont été celles avec des réfugiés et des migrants. Nous avons
organisé une action nationale ininterrompue en faveur du droit d’asile
avec des réfugiés iraniens et le soutien d’Eglises, du 15 juin 1997 au
30 novembre 1997. Il nous a fallu une année pour la préparer et,
pendant ce temps, nous avons organisé des actions plus petites avec ces
réfugiés afin d’attirer l’attention des médias. Nous avons aussi
organisé une caravane nationale de protestation avec plusieurs dizaines
de sans-papiers en septembre 1998. Nous avons soutenu des grèves de la
faim à La Haye et à Amsterdam, en intervenant quotidiennement en
décembre 1998 (pour 135 travailleurs immigrés), en février-mars 1999
(pour 16 migrantes), en février-mars 1999 (pour 34 migrants), en
février-mai 2001 (pour 5 réfugiés), en mars-mai 2003 (pour 15
travailleurs immigrés). Nous avons également organisé beaucoup
d’actions et de manifestations, par exemple contre les nouvelles lois
favorables au contrôle des migrations ou contre les fascistes. Nous
avons organisé de grandes conférences pour marquer l’importance de
certaines dates commémoratives (par exemple, contre la Nuit de
cristal), et des actions de protestations contre la visite de
politiciens ou de leaders d’opinion réactionnaires à Leiden.
Eric :
Nous avons probablement organisé entre 100 et 150 actions au cours des
15 dernières années, de grandes actions comme de petites. Les actions
importantes ont souvent été menées avec d’autres organisations. Il
m’est impossible de les nommer toutes. Les actions les plus importantes
pour nous ont été celles avec des réfugiés et des migrants. Nous avons
organisé une action nationale ininterrompue en faveur du droit d’asile
avec des réfugiés iraniens et le soutien d’Eglises, du 15 juin 1997 au
30 novembre 1997. Il nous a fallu une année pour la préparer et,
pendant ce temps, nous avons organisé des actions plus petites avec ces
réfugiés afin d’attirer l’attention des médias. Nous avons aussi
organisé une caravane nationale de protestation avec plusieurs dizaines
de sans-papiers en septembre 1998. Nous avons soutenu des grèves de la
faim à La Haye et à Amsterdam, en intervenant quotidiennement en
décembre 1998 (pour 135 travailleurs immigrés), en février-mars 1999
(pour 16 migrantes), en février-mars 1999 (pour 34 migrants), en
février-mai 2001 (pour 5 réfugiés), en mars-mai 2003 (pour 15
travailleurs immigrés). Nous avons également organisé beaucoup
d’actions et de manifestations, par exemple contre les nouvelles lois
favorables au contrôle des migrations ou contre les fascistes. Nous
avons organisé de grandes conférences pour marquer l’importance de
certaines dates commémoratives (par exemple, contre la Nuit de
cristal), et des actions de protestations contre la visite de
politiciens ou de leaders d’opinion réactionnaires à Leiden.
![]() Harry : Et bien sûr nous allons à d’autres types de manifestations et y distribuons nos tracts.
Harry : Et bien sûr nous allons à d’autres types de manifestations et y distribuons nos tracts.
![]() Comment fonctionne votre coopération avec d’autres organisations ?
Comment fonctionne votre coopération avec d’autres organisations ?
![]() Eric :
Habituellement nous créons une plateforme avec plusieurs organisations
de migrants et de réfugiés et quelques associations de soutien. Nous
discutons des projets des immigrés et nous cherchons à savoir comment
les soutenir. Pendant les grèves de la faim, par exemple, un comité de
soutien qui se réunissait tous les jours a été formé et c’est lui qui
organisait le soutien. Cela signifie discuter de la stratégie avec les
grévistes de la faim, collecter de l’argent, contacter des médecins
pour qu’ils les examinent régulièrement, demander à des hommes
politiques de venir soutenir les grévistes, organiser des
manifestations, écrire et envoyer des communiqués de presse, et parfois
essayer de jouer un rôle modérateur quand des tensions trop vives
apparaissent au sein des soutiens.
Eric :
Habituellement nous créons une plateforme avec plusieurs organisations
de migrants et de réfugiés et quelques associations de soutien. Nous
discutons des projets des immigrés et nous cherchons à savoir comment
les soutenir. Pendant les grèves de la faim, par exemple, un comité de
soutien qui se réunissait tous les jours a été formé et c’est lui qui
organisait le soutien. Cela signifie discuter de la stratégie avec les
grévistes de la faim, collecter de l’argent, contacter des médecins
pour qu’ils les examinent régulièrement, demander à des hommes
politiques de venir soutenir les grévistes, organiser des
manifestations, écrire et envoyer des communiqués de presse, et parfois
essayer de jouer un rôle modérateur quand des tensions trop vives
apparaissent au sein des soutiens.

![]() « De Fabel » est-il une organisation locale ou nationale ?
« De Fabel » est-il une organisation locale ou nationale ?
![]() Eric :
Nous avons été pendant longtemps une organisation locale. Ce serait
mieux si les Pays-Bas étaient couverts d’associations de soutien comme
la nôtre, et que chacune s’occupe des questions de sa région et
rencontre les autres pour organiser des protestations nationales. Nous
avons essayé de créer de telles structures plusieurs fois. Mais, comme
les groupes semblables au nôtre dans d’autres villes ont disparu ou
sont trop engagés dans un travail de soutien uniquement individuel aux
immigrés et aux réfugiés, nous sommes parfois obligés d’agir plus ou
moins seuls à l’échelle nationale. Des organisations d’immigrés à La
Haye ou dans d’autres villes nous contactent parce qu’il n’y a plus
d’associations de soutien dans leur coin.
Eric :
Nous avons été pendant longtemps une organisation locale. Ce serait
mieux si les Pays-Bas étaient couverts d’associations de soutien comme
la nôtre, et que chacune s’occupe des questions de sa région et
rencontre les autres pour organiser des protestations nationales. Nous
avons essayé de créer de telles structures plusieurs fois. Mais, comme
les groupes semblables au nôtre dans d’autres villes ont disparu ou
sont trop engagés dans un travail de soutien uniquement individuel aux
immigrés et aux réfugiés, nous sommes parfois obligés d’agir plus ou
moins seuls à l’échelle nationale. Des organisations d’immigrés à La
Haye ou dans d’autres villes nous contactent parce qu’il n’y a plus
d’associations de soutien dans leur coin.
![]() Pouvez-nous parler de votre journal ?
Pouvez-nous parler de votre journal ?
![]() Jan :
Notre journal paraît tous les deux mois et nous imprimons 1500
exemplaires, en format tabloïd de 16 pages. Les gens peuvent s’abonner,
ou nous soutenir financièrement, mais nous le distribuons gratuitement
pendant les manifestations.
Jan :
Notre journal paraît tous les deux mois et nous imprimons 1500
exemplaires, en format tabloïd de 16 pages. Les gens peuvent s’abonner,
ou nous soutenir financièrement, mais nous le distribuons gratuitement
pendant les manifestations.
![]() Est-il sur Internet ?
Est-il sur Internet ?
![]() Jan :
Tout ce que nous publions depuis 15 ans est sur la Toile. Nous avons 2
500 articles, brochures et communiqués de presse sur notre site. Et 120
textes traduits. Notre site est visité par 40 000 personnes chaque
mois, qui consultent un total de 150 000 pages. Beaucoup de nos
articles apparaissent en première place, lorsque l’on fait une
recherche sur Google. Quand les gens s’intéressent à l’Organisation
internationale des migrations, par exemple, ils tombent sur nous tout
de suite. Dans ce sens, on peut dire que nous « contrôlons » une partie
de l’information sur ce sujet. Internet nous apporte aussi beaucoup de
courriels hostiles et nous avons très rarement des discussions ou des
contacts intéressants par l’intermédiaire du Net. Mais nous avons quand
même gagné quelques nouveaux amis comme… « Ni patrie ni frontières » !
Jan :
Tout ce que nous publions depuis 15 ans est sur la Toile. Nous avons 2
500 articles, brochures et communiqués de presse sur notre site. Et 120
textes traduits. Notre site est visité par 40 000 personnes chaque
mois, qui consultent un total de 150 000 pages. Beaucoup de nos
articles apparaissent en première place, lorsque l’on fait une
recherche sur Google. Quand les gens s’intéressent à l’Organisation
internationale des migrations, par exemple, ils tombent sur nous tout
de suite. Dans ce sens, on peut dire que nous « contrôlons » une partie
de l’information sur ce sujet. Internet nous apporte aussi beaucoup de
courriels hostiles et nous avons très rarement des discussions ou des
contacts intéressants par l’intermédiaire du Net. Mais nous avons quand
même gagné quelques nouveaux amis comme… « Ni patrie ni frontières » !
![]() Combien
d’heures par semaine consacrez-vous à votre activité politique ?
Travaillez-vous et dans quelle branche ? Quelle est la relation entre
votre militantisme politique et votre travail ?
Combien
d’heures par semaine consacrez-vous à votre activité politique ?
Travaillez-vous et dans quelle branche ? Quelle est la relation entre
votre militantisme politique et votre travail ?
![]() Jan :
Jusqu’à il y a un an, j’étais au chômage et je pouvais passer beaucoup
de temps avec « De Fabel ». Maintenant je travaille 45 heures par
semaine dans un entrepôt. J’essaie d’être actif autant que possible le
soir et le week-end. Mais j’aimerais passer plus de temps à militer. À
mon travail, je peux m’exprimer sans problème, mais je n’ai pas
d’activités politiques. Je ne suis pas membre du syndicat, mais je me
pose la question. Le syndicat pourrait éventuellement m’aider en cas de
situation difficile.
Jan :
Jusqu’à il y a un an, j’étais au chômage et je pouvais passer beaucoup
de temps avec « De Fabel ». Maintenant je travaille 45 heures par
semaine dans un entrepôt. J’essaie d’être actif autant que possible le
soir et le week-end. Mais j’aimerais passer plus de temps à militer. À
mon travail, je peux m’exprimer sans problème, mais je n’ai pas
d’activités politiques. Je ne suis pas membre du syndicat, mais je me
pose la question. Le syndicat pourrait éventuellement m’aider en cas de
situation difficile.
![]() Ellen :
J’ai toujours eu des emplois à temps partiel parce que je ne veux pas
que le travail me bouffe toute ma semaine. J’ai donc le temps de
militer. Dans mon boulot précédent, mes collègues étaient plus
féministes et à gauche que dans celui que j’occupe maintenant. Ils
étaient moins satisfaits de la hiérarchie et des conditions de travail.
À l’époque, j’appartenais au syndicat et nous participions à des
manifestations pour de meilleurs salaires ou conditions de travail.
Cela est impossible avec mes collègues actuels. Mais je dois avouer
aussi que je ne suis pas une syndicaliste très active. Dans mon
secteur, la santé et le travail social, la plupart des travailleurs ne
sont pas très militants, et le syndicat encore moins.
Ellen :
J’ai toujours eu des emplois à temps partiel parce que je ne veux pas
que le travail me bouffe toute ma semaine. J’ai donc le temps de
militer. Dans mon boulot précédent, mes collègues étaient plus
féministes et à gauche que dans celui que j’occupe maintenant. Ils
étaient moins satisfaits de la hiérarchie et des conditions de travail.
À l’époque, j’appartenais au syndicat et nous participions à des
manifestations pour de meilleurs salaires ou conditions de travail.
Cela est impossible avec mes collègues actuels. Mais je dois avouer
aussi que je ne suis pas une syndicaliste très active. Dans mon
secteur, la santé et le travail social, la plupart des travailleurs ne
sont pas très militants, et le syndicat encore moins.
![]() Eric :
Harry, Gerrit et moi sommes payés indirectement par le conseil
municipal pour travailler… à « De Fabel ». [Depuis que cette interview
a été réalisée, tous les trois sont au chômage, NPNF] En effet, dans
les années 1990, le gouvernement a créé des dizaines de milliers
d’emplois payés au SMIC pour les chômeurs. Les employeurs recevaient
des subventions généreuses s’ils employaient ces salariés sous-payés et
sous-protégés au niveau de la Sécurité sociale comme de la retraite.
Officiellement, les patrons n’avaient pas le droit de remplacer leurs
salariés par ces smicards qui ne leur coûtaient pas un sou. En
pratique, cependant, beaucoup d’écoles et d’entreprises à but non
lucratif ont utilisé ces smicards pour remplacer des postes qui avaient
été supprimés suite à des coupes budgétaires. Grâce à ces smicards
subventionnés, le gouvernement voulait remettre au travail et
discipliner les chômeurs, et leur donner une petite expérience
professionnelle qui augmenterait un peu leur valeur sur le marché du
travail. Nous nous sommes constitué en association et avons réussi à
obtenir trois SMIC subventionnés pour nous embaucher nous-mêmes. Même
si la paie est petite (moins de 800 euros) et que nous n’aurons aucune
retraite (juste le minimum vieillesse), nous aimons notre mode de vie.
Nous sommes nos propres maîtres, et le conseil municipal ne met pas son
nez dans nos affaires. Ces smics subventionnés vont être supprimés en
janvier 2007 et nous devrons trouver d’autres façons de continuer notre
travail politique. Le gouvernement prévoit de créer de nouveaux emplois
subventionnés, mais qui seraient payés encore moins, soit 70% du SMIC,
c’est-à-dire l’équivalent des allocations chômage.
Eric :
Harry, Gerrit et moi sommes payés indirectement par le conseil
municipal pour travailler… à « De Fabel ». [Depuis que cette interview
a été réalisée, tous les trois sont au chômage, NPNF] En effet, dans
les années 1990, le gouvernement a créé des dizaines de milliers
d’emplois payés au SMIC pour les chômeurs. Les employeurs recevaient
des subventions généreuses s’ils employaient ces salariés sous-payés et
sous-protégés au niveau de la Sécurité sociale comme de la retraite.
Officiellement, les patrons n’avaient pas le droit de remplacer leurs
salariés par ces smicards qui ne leur coûtaient pas un sou. En
pratique, cependant, beaucoup d’écoles et d’entreprises à but non
lucratif ont utilisé ces smicards pour remplacer des postes qui avaient
été supprimés suite à des coupes budgétaires. Grâce à ces smicards
subventionnés, le gouvernement voulait remettre au travail et
discipliner les chômeurs, et leur donner une petite expérience
professionnelle qui augmenterait un peu leur valeur sur le marché du
travail. Nous nous sommes constitué en association et avons réussi à
obtenir trois SMIC subventionnés pour nous embaucher nous-mêmes. Même
si la paie est petite (moins de 800 euros) et que nous n’aurons aucune
retraite (juste le minimum vieillesse), nous aimons notre mode de vie.
Nous sommes nos propres maîtres, et le conseil municipal ne met pas son
nez dans nos affaires. Ces smics subventionnés vont être supprimés en
janvier 2007 et nous devrons trouver d’autres façons de continuer notre
travail politique. Le gouvernement prévoit de créer de nouveaux emplois
subventionnés, mais qui seraient payés encore moins, soit 70% du SMIC,
c’est-à-dire l’équivalent des allocations chômage.
![]() Comment combinez-vous vie personnelle et vie politique ?
Comment combinez-vous vie personnelle et vie politique ?
![]() Eric :
Nous prenons le temps de parler des questions personnelles. Nous sommes
attentifs à la façon dont chacun se sent et nous essayons de nous aider
et de nous soutenir mutuellement dans la mesure du possible. La plupart
d’entre nous vivent dans des maisons collectives avec d’autres
militants, et nous nous connaissons bien désormais. Nous essayons de ne
pas trop séparer vie personnelle et vie politique. Mais, bien sûr,
chacun est libre de confier aux autres ce qu’il veut, et si elle (ou
il) ne tient pas à partager certains sentiments ou certaines pensées,
cela ne pose pas de problème. Pour réussir à avoir confiance les uns
dans les autres en tant que militants, nous devons lier des relations
étroites, personnelles et sociales. Je crois que, sans ces liens, les
organisations ne durent pas très longtemps.
Eric :
Nous prenons le temps de parler des questions personnelles. Nous sommes
attentifs à la façon dont chacun se sent et nous essayons de nous aider
et de nous soutenir mutuellement dans la mesure du possible. La plupart
d’entre nous vivent dans des maisons collectives avec d’autres
militants, et nous nous connaissons bien désormais. Nous essayons de ne
pas trop séparer vie personnelle et vie politique. Mais, bien sûr,
chacun est libre de confier aux autres ce qu’il veut, et si elle (ou
il) ne tient pas à partager certains sentiments ou certaines pensées,
cela ne pose pas de problème. Pour réussir à avoir confiance les uns
dans les autres en tant que militants, nous devons lier des relations
étroites, personnelles et sociales. Je crois que, sans ces liens, les
organisations ne durent pas très longtemps.

![]() Quelles sont vos relations avec les partis de gauche ?
Quelles sont vos relations avec les partis de gauche ?
![]() Eric :
Le parti travailliste social-démocrate (PvdA) est fréquemment au
pouvoir. Au cours des 20 dernières années, c’est souvent un membre du
PvdA qui a occupé le poste de ministre de la Justice, chargé de
l’immigration. La plupart des lois répressives actuelles ont été
initiées par des ministres sociaux-démocrates. Ils sont au pouvoir en
ce moment. Mais nous n’avons jamais de bonnes relations avec eux, même
sur le plan local. Ensuite, il y a GroenLinks (la Gauche verte) qui
rassemble des anciens communistes, des pacifistes et des socialistes.
Ils attirent les gens de gauche aisés et obtiennent généralement 5% des
voix. Les Verts sont maintenant dépassés par le SP (Parti Socialiste),
un ex-parti maoïste.
Eric :
Le parti travailliste social-démocrate (PvdA) est fréquemment au
pouvoir. Au cours des 20 dernières années, c’est souvent un membre du
PvdA qui a occupé le poste de ministre de la Justice, chargé de
l’immigration. La plupart des lois répressives actuelles ont été
initiées par des ministres sociaux-démocrates. Ils sont au pouvoir en
ce moment. Mais nous n’avons jamais de bonnes relations avec eux, même
sur le plan local. Ensuite, il y a GroenLinks (la Gauche verte) qui
rassemble des anciens communistes, des pacifistes et des socialistes.
Ils attirent les gens de gauche aisés et obtiennent généralement 5% des
voix. Les Verts sont maintenant dépassés par le SP (Parti Socialiste),
un ex-parti maoïste.
Le SP a toujours été partiellement nationaliste et raciste. Il se vante d’avoir été le premier à lancer le débat sur l’intégration, qui a permis à tous les racistes de se déchaîner. Ses dirigeants croient que les travailleurs immigrés affaiblissent le mouvement ouvrier néerlandais. Ils pensent que c’est aussi le cas du féminisme. Cependant, ils soutiennent parfois certaines de nos revendications concrètes et ils ont pris la parole lors de certaines de nos manifestations importantes. Ensuite, on trouve différents petits groupes, comme les Internationale Socialisten, proches du SWP britannique. Nous sommes d’accord avec la plupart de ce qu’ils écrivent contre le contrôle de l’immigration, mais en désaccord sur la question du nationalisme et des mouvements de libération nationale. Nous nous rencontrons souvent dans les manifestations, mais il n’est pas possible de coopérer avec eux car ils essayent tout le temps de debaucher les gens pour les intégrer dans leur organisation très hiérarchisée. Ils n’arrêtent pas de sauter d’un thème d’intervention à un autre pour attirer davantage de membres. Il y a aussi un autre groupe trotskyste, le SAP (Politique alternative socialiste). De tous les groupes communistes, c’est celui dont nous sommes le plus proches. L’un de nos membres a rejoint le SAP il y a quelques années. Comme nous, ils ont participé à la création de la plateforme Geen mens is illegal (Personne n’est illegal), mais, au bout de quelques réunions, ils ont arrêté de venir. Nous n’avons pas de coopération concrète avec eux en ce moment. Et enfin il existe différents petits groupes staliniens. Nous n’avons aucun contact avec eux.
![]() Quel a été l’événement politique le plus important de ta vie militante ?
Quel a été l’événement politique le plus important de ta vie militante ?
![]() Jan :
La gauche révolutionnaire n’est pas en bonne santé depuis une quinzaine
d’années. Vu mon âge, je n’ai pas encore eu de moments marquants dans
ma vie militante.
Jan :
La gauche révolutionnaire n’est pas en bonne santé depuis une quinzaine
d’années. Vu mon âge, je n’ai pas encore eu de moments marquants dans
ma vie militante.
![]() Eric :
En 1989, près de 10 000 militants ont encerclé et bloqué le siège de la
Shell à Amsterdam. Cela a été un moment extrêmement fort et émouvant
pour moi. Nous agissions avec beaucoup de gens qui avaient des idées
radicales, y compris des membres de la Résistance sud-africaine. Et il
y a eu aussi les grèves de la faim à Amsterdam en 1999. Je discutais
avec les travailleurs immigrés tous les jours, je les soutenais, je
leur parlais, nous organisions des manifestations, nos réunions se
terminaient très tard dans la nuit. C’était une expérience à la fois
enthousiasmante et épuisante, et j’avais vraiment l’impression de faire
partie d’un mouvement plus large.
Eric :
En 1989, près de 10 000 militants ont encerclé et bloqué le siège de la
Shell à Amsterdam. Cela a été un moment extrêmement fort et émouvant
pour moi. Nous agissions avec beaucoup de gens qui avaient des idées
radicales, y compris des membres de la Résistance sud-africaine. Et il
y a eu aussi les grèves de la faim à Amsterdam en 1999. Je discutais
avec les travailleurs immigrés tous les jours, je les soutenais, je
leur parlais, nous organisions des manifestations, nos réunions se
terminaient très tard dans la nuit. C’était une expérience à la fois
enthousiasmante et épuisante, et j’avais vraiment l’impression de faire
partie d’un mouvement plus large.
![]() Ellen :
Je pense que je choisirais les mêmes événements qu’Eric. Mais j’ai été
plus impliquée personnellement dans la grève de la faim de 1998.
J’allais voir les grévistes presque tous les jours. Je sentais qu’il
s’agissait d’une phase importante de la lutte des sans-papiers aux
Pays-Bas. Au bout de deux semaines et demie un comité de négociation a
été créé avec le leader d’un syndicat et des dirigeants des Eglises.
Lors de leur dernière offre, tous les grévistes de la faim et leurs
soutiens ont passé la nuit à discuter de la proposition. Tout le monde
était fatigué et vulnérable. Bien sûr, chaque gréviste de la faim
pensait à ses chances personnelles d’obtenir des papiers, mais personne
ne voulait être égoïste. Les grévistes désiraient tous que chacun s’en
sorte, y compris les autres immigrés qui étaient dans la même
situation. Cela a été une nuit remplie d’émotion.
Ellen :
Je pense que je choisirais les mêmes événements qu’Eric. Mais j’ai été
plus impliquée personnellement dans la grève de la faim de 1998.
J’allais voir les grévistes presque tous les jours. Je sentais qu’il
s’agissait d’une phase importante de la lutte des sans-papiers aux
Pays-Bas. Au bout de deux semaines et demie un comité de négociation a
été créé avec le leader d’un syndicat et des dirigeants des Eglises.
Lors de leur dernière offre, tous les grévistes de la faim et leurs
soutiens ont passé la nuit à discuter de la proposition. Tout le monde
était fatigué et vulnérable. Bien sûr, chaque gréviste de la faim
pensait à ses chances personnelles d’obtenir des papiers, mais personne
ne voulait être égoïste. Les grévistes désiraient tous que chacun s’en
sorte, y compris les autres immigrés qui étaient dans la même
situation. Cela a été une nuit remplie d’émotion.
![]() Harry :
L’événement le plus important pour moi, c’est quand je me suis décidé à
devenir un militant politique à plein temps, à m’engager
quotidiennement de façon organisée, et à travailler à une forme de
révolution. En deuxième lieu, l’engagement que nous avons pris, en
1990, avec 4 ou 5 camarades, de lutter non pas pendant quelques années
mais pour le reste de notre vie. Le combat continue ! Et enfin, le
moment le plus important pour moi est peut-être la grève de la faim la
plus récente. Elle a duré 57 jours, parce que c’était pour les
grévistes la seule façon de lutter, et cette lutte m’a beaucoup marqué.
Harry :
L’événement le plus important pour moi, c’est quand je me suis décidé à
devenir un militant politique à plein temps, à m’engager
quotidiennement de façon organisée, et à travailler à une forme de
révolution. En deuxième lieu, l’engagement que nous avons pris, en
1990, avec 4 ou 5 camarades, de lutter non pas pendant quelques années
mais pour le reste de notre vie. Le combat continue ! Et enfin, le
moment le plus important pour moi est peut-être la grève de la faim la
plus récente. Elle a duré 57 jours, parce que c’était pour les
grévistes la seule façon de lutter, et cette lutte m’a beaucoup marqué.
![]() Qu’est-ce que « De Fabel » vous a apporté ? Et quelles ont été vos expériences négatives ?
Qu’est-ce que « De Fabel » vous a apporté ? Et quelles ont été vos expériences négatives ?
![]() Jan :
J’ai appris à écrire un article et à parler en public. J’ai aussi
appris à analyser les relations de pouvoir dans la société et à avancer
des arguments pour un changement social radical. Sur le plan négatif,
je suis très déçu par certains camarades qui ont quitté le groupe et
n’ont plus aucune activité politique.
Jan :
J’ai appris à écrire un article et à parler en public. J’ai aussi
appris à analyser les relations de pouvoir dans la société et à avancer
des arguments pour un changement social radical. Sur le plan négatif,
je suis très déçu par certains camarades qui ont quitté le groupe et
n’ont plus aucune activité politique.
![]() Eric :
Pour moi le plus important est d’arriver à faire un travail collectif
et responsible. De défendre des idées dans la gauche révolutionnaire en
général. Et de participer à la lutte historique pour un monde meilleur.
Ce qui est négatif, c’est l’état général de l’extrême gauche en ce
moment. La situation se détériore d’année en année.
Eric :
Pour moi le plus important est d’arriver à faire un travail collectif
et responsible. De défendre des idées dans la gauche révolutionnaire en
général. Et de participer à la lutte historique pour un monde meilleur.
Ce qui est négatif, c’est l’état général de l’extrême gauche en ce
moment. La situation se détériore d’année en année.
![]() Ellen :
J’ai appris beaucoup de choses en militant à De Fabel, en lisant,
discutant, en faisant des recherches, en écrivant et en organisant des
actions. J’ai aussi appris la patience. Il faut des années, ou même des
décennies, pour que les choses changent. Nous n’avons pas le pouvoir de
forcer les changements. Il est difficile de rester très optimiste si
l’on considère les petites victoires que nous avons remportées. Et je
n’ai pas l’impression que beaucoup de gens aient vraiment envie que le
monde change. Avant, je croyais que les choses allaient s’améliorer
dans les deux ou trois ans à venir. Mais l’atmosphère
ultraréactionnaire et raciste pèse de plus en plus aux Pays-Bas. Mais
nous devons continuer, c’est toujours mieux que de ne rien faire et de
baisser les bras.
Ellen :
J’ai appris beaucoup de choses en militant à De Fabel, en lisant,
discutant, en faisant des recherches, en écrivant et en organisant des
actions. J’ai aussi appris la patience. Il faut des années, ou même des
décennies, pour que les choses changent. Nous n’avons pas le pouvoir de
forcer les changements. Il est difficile de rester très optimiste si
l’on considère les petites victoires que nous avons remportées. Et je
n’ai pas l’impression que beaucoup de gens aient vraiment envie que le
monde change. Avant, je croyais que les choses allaient s’améliorer
dans les deux ou trois ans à venir. Mais l’atmosphère
ultraréactionnaire et raciste pèse de plus en plus aux Pays-Bas. Mais
nous devons continuer, c’est toujours mieux que de ne rien faire et de
baisser les bras.
![]() Harry :
Parmi les choses très positives, je mentionnerais la possibilité de
militer quotidiennement, de prendre des responsabilités et de créer des
structures de lutte et d’organisation. L’expérience d’être vraiment
impliqué dans des combats politiques, les connaissances que l’on
partage avec les autres camarades. J’ai moi aussi un jugement négatif
sur la gauche révolutionnaire et ceux qui abandonnent. Mais encore plus
vis-à-vis de ceux qui ne sont même plus passifs, par exemple, qui ne
donnent même pas d’argent. Comment peuvent-ils complètement oublier,
ignorer, leurs engagements politiques passés ? Mais j’ai aussi appris
de ces expériences négatives. Je dois m’améliorer, essayer de nouveau
et avec plus de détermination.
Harry :
Parmi les choses très positives, je mentionnerais la possibilité de
militer quotidiennement, de prendre des responsabilités et de créer des
structures de lutte et d’organisation. L’expérience d’être vraiment
impliqué dans des combats politiques, les connaissances que l’on
partage avec les autres camarades. J’ai moi aussi un jugement négatif
sur la gauche révolutionnaire et ceux qui abandonnent. Mais encore plus
vis-à-vis de ceux qui ne sont même plus passifs, par exemple, qui ne
donnent même pas d’argent. Comment peuvent-ils complètement oublier,
ignorer, leurs engagements politiques passés ? Mais j’ai aussi appris
de ces expériences négatives. Je dois m’améliorer, essayer de nouveau
et avec plus de détermination.
![]() Comment envisagez-vous l’avenir de « De Fabel » ?
Comment envisagez-vous l’avenir de « De Fabel » ?
![]() Eric :
Si j’en crois notre expérience au cours des 15 dernières années, je
crois que nous continuerons à être un groupe avec 5 ou 6 camarades
actifs. Nous sentons que nous avons une responsabilité en tant que
militants révolutionnaires et donc nous continuerons notre engagement.
Les circonstances dans lesquelles nous opérerons seront sans doute
différentes dans 10 ans, mais nous continuerons probablement à lutter à
partir de la base et construire des structures politiques. Nous
continuerons à réfléchir à des moyens de faciliter des changements
sociaux fondamentaux. Mais nous sommes un petit groupe, et, étant donné
l’atmosphère réactionnaire qui domine dans ce pays, je pense que dans
le futur proche peu de personnes nous rejoindront et que nous aurons
une attitude plutôt défensive. Nous ne sommes pas en position de créer
un nouveau mouvement social. Mais nous serons toujours vigilants si
jamais cela arrive. Il y aura toujours des hommes et des femmes pour
protester contre l’injustice, et il faut que nous soyons là pour leur
donner un coup de main.
Eric :
Si j’en crois notre expérience au cours des 15 dernières années, je
crois que nous continuerons à être un groupe avec 5 ou 6 camarades
actifs. Nous sentons que nous avons une responsabilité en tant que
militants révolutionnaires et donc nous continuerons notre engagement.
Les circonstances dans lesquelles nous opérerons seront sans doute
différentes dans 10 ans, mais nous continuerons probablement à lutter à
partir de la base et construire des structures politiques. Nous
continuerons à réfléchir à des moyens de faciliter des changements
sociaux fondamentaux. Mais nous sommes un petit groupe, et, étant donné
l’atmosphère réactionnaire qui domine dans ce pays, je pense que dans
le futur proche peu de personnes nous rejoindront et que nous aurons
une attitude plutôt défensive. Nous ne sommes pas en position de créer
un nouveau mouvement social. Mais nous serons toujours vigilants si
jamais cela arrive. Il y aura toujours des hommes et des femmes pour
protester contre l’injustice, et il faut que nous soyons là pour leur
donner un coup de main.

POST-SCRIPTUM (avril 2008) :
À l’époque où a été réalisée cette interview, « De Fabel » était engagé dans la « Plateforme contre l’intégration forcée », que nous avions fondée avec un petit groupe de Turco-Néerlandais : Aksi (grosso modo cela signifie les « fauteurs de troubles », en turc). Nous avons découvert que nous avions beaucoup de points communs et avons décidé de créer ensemble une nouvelle organisation : « Doorbraak » que nous avons créée en janvier 2007 avec une douzaine de personnes. « Doorbraak » signifie « La Percée », terme qui symbolise le fait de briser les murs entre différentes communautés et différents courants politiques et de commencer quelque chose de nouveau, sans bien sûr rejeter tout ce qu’il y a de bon dans la gauche révolutionnaire.
Nous avons décidé, pour commencer, de nous investir dans la lutte contre le contrôle des migrations et le racisme au sens large. Nous menons des campagnes contre le populisme de droite (Wilders), le colonialisme, l’intégration forcée, l’extrême droite turque, le contrôle des migrations et les luttes des travailleurs (en particulier dans le secteur du nettoyage). Ces thèmes permettent de nouer des liens avec des organisations et des gens de différentes origines qui normalement ne coopèrent pas ensemble politiquement. La gauche, aux Pays-Bas, est traditionnellement très « blanche » et nous essayons de changer cela.
Nous avons pris le temps de nous organiser, localement et nationalement désormais, et d’avoir des discussions internes. Mais en même temps nous avons organisé 8 réunions publiques contre Wilders dans tout le pays, deux manifestations contre Wilders et le colonialisme, etc. Nous avons doublé nos effectifs, de toutes origines sur le plan politique et « ethnique ». Nous ne voulons pas adopter une étiquette (anarchiste, ou communiste), et nous essayons d’avoir l’esprit ouvert vis-à-vis d’autres organisations et courants. Certains de nos membres font en même temps partie du SP, parti ex-maoïste (nous avons même eu pendant quelque temps un député du SP !) et d’autres se sentent plutôt anarchistes. Nous pensons tous que la gauche révolutionnaire est dans une situation tellement mauvaise qu’aucun courant politique n’a les capacités et les idées suffisantes pour convaincre les travailleurs et changer la situation. Notre point de départ est donc de douter de toutes les idées révolutionnaires, mais nous sommes bien sûr contre le capitalisme, le patriarcat et le racisme. Dernier point sur nos « emplois ». Les trois d’entre nous qui avaient « la chance » d’avoir des emplois payés au SMIC et sans couverture sociale les ont perdus en janvier 2007. Nous sommes désormais suivis par des agences de placement privées. En attendant, nous touchons environ 700 euros de la Sécurité sociale. Nous réussissons à survivre et à continuer notre travail politique pour « De Fabel ». Vu notre âge, il n’est pas du tout évident que nous retrouvions du boulot rapidement.
Source : « Ni patrie Ni frontières »